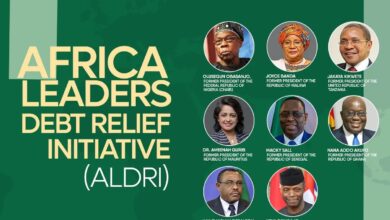Le Cameroun veut limiter les impacts des secteurs de développement sur la biodiversité
Une feuille de route relative à la gestion de la biodiversité lors de l’évaluation environnementale des grands projets de développement conçue aux termes des travaux du deuxième dialogue national multi-acteurs du projet Biodev2030, organisés par le Fonds mondial pour la nature (WWF-Cameroun), le 1er et 2 avril dernier à Mbankomo dans le département de la Mefou et Akono.

Edifier les participants (responsables administratifs, autorités traditionnelles, experts, chercheurs et représentants des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de l’environnement et de la biodiversité) sur l’empreinte sectorielle sur la biodiversité au Cameroun, sur les potentielles réformes dans le secteur agricole notamment le cacao, les plantations d’hévéa et de palmier à huile ; identifier et caractérisées les réformes pertinentes ; valider la liste de réformes à introduire dans le NBSAP III (Stratégie et Plan d’Action National pour la biodiversité). Tels sont les objectifs du deuxième dialogue national multi-acteurs du projet Biodev 2030 tenu le 1er et 2 avril 2025 à Mbankomo dans la Mefou et Akono au Cameroun. « Le deuxième dialogue national est une continuité du premier, visant à intégrer la biodiversité dans les projets de développement de manière inclusive », renseigne Alain Bernard Ononino, directeur national du Fonds mondial pour la nature (WWF) au Cameroun.
Lancée en 2020 dans 16 pays pilotes dont le Cameroun, l’initiative Biodev2030 promeut un dialogue multipartite pour intégrer la biodiversité dans les stratégies de développement économique. La première phase du projet entre 2019 et 2022, a permis a-t-il souligné, d’identifier l’agriculture, les infrastructures et les plantations commerciales comme des secteurs qui ont le plus grand impact sur la biodiversité au Cameroun. Selon les analystes, la production du cacao, de l’huile de palme et de l’hévéa contribue de manière importante à la déforestation, la dégradation des sols et à la perte de la biodiversité. L’implémentation de la phase 2 du projet, objet de la rencontre de Mbankomo met un accent particulier sur l’intégration des instruments de politiques publiques sectorielles (IPPS) dans les stratégies nationales, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Pour le Cameroun, Il s’agit précisément d’accompagner le pays dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et des engagements liés à la biodiversité post-2020.
Le dialogue national, un moment clé pour aborder l’intégration des IPPS (Instruments de politiques publiques sectorielles) dans le NBSAP III (Stratégie et Plan d’Action National pour la biodiversité), afin de garantir une cohérence entre les objectifs de développement économique et les objectifs de gestion durable de la biodiversité
La révision du NBSAP II est en cours. Sa troisième génération doit pouvoir intégrer les recommandations concrètes pour mieux gérer les impacts des secteurs de développement sur la biodiversité. Les assises du deuxième dialogue national ont permis de plancher sur cette question afin de garantir une cohérence entre les objectifs de développement économique et ceux de gestion durable de la biodiversité. « La biodiversité est source de notre alimentation et de notre vie. Il faut donc l’exploiter de façon durable », a rappelé Pierre Hélé, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, président des travaux avant d’inviter chacune des sectorielles à l’œuvre pour le développement économique du pays, à renouveler leurs engagements en matière de gestion durable de la biodiversité pour les générations futures. Afin de s’assurer que les projets de développement sont compatibles avec les objectifs de préservation de la biodiversité, la réflexion a également porté sur la mise en place d’un référentiel pour la prise en compte de la biodiversité dans les études d’impact des projets de développement. Celui-ci va guider les promoteurs de projets dans l’intégration des préoccupations environnementales et de biodiversité dès les premières étapes de conception des projets.
Nadège Christelle BOWA