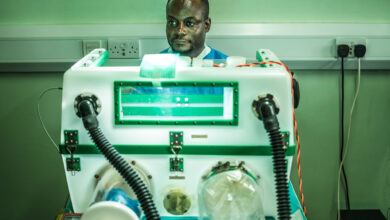Marie Emma Ndjiba Nkodo : « Tant que l’ulcère de buruli va toucher un seul camerounais, il y aura urgence »

Les 20 et 21 avril 2022 se sont tenus à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Yaoundé, les travaux du Symposium sur les Maladies tropicales négligées (Mtn) sous le thème : « Atteindre l’équité en santé pour mettre fin à la négligence des maladies liées à la pauvreté ». Doctorante en sociologie à l’université de Yaoundé I, Marie Emma Ndjiba Epse Nkodo, y a pris une part active au cours de laquelle elle a présenté au parterre d’experts une enquête réalisée dans le cadre de son projet de thèse. Celle-ci met en lumière la prise en charge de la Covid-19 sur le site de l’hôpital de district d’Akonolinga, formation sanitaire « de référence » pour le traitement de l’ulcère de buruli, une maladie tropicale négligée. Les principaux résultats de ses travaux ainsi que ses recommandations dans cet entretien accordé à votre journal.
Vous avez réalisé une enquête sur la prise en charge de l’Ulcère de Buruli pendant la covid-19 précisément dans la localité d’Akonolinga. Que peut-on retenir de vos résultats ?
Je suis en train de rédiger une thèse sur l’Ulcère de Buruli notamment les différentes voies thérapeutiques choisies par les malades au Cameroun. Akonolinga est un de mes sites parce qu’on y retrouve au moins un hôpital de référence de prise en charge de cette maladie. Pendant les descentes sur le terrain, j’ai pensé mettre en rapport la prise en charge de l’Ulcère de Buruli et le Covid-19. C’est vrai que le Covid-19 nous est tous tombé dessus. Sauf que si nous considérons que l’Ulcère de Buruli est une Maladie tropicale négligée (Mtn), ce qui veut dire que les malades vivent déjà dans un abandon total, je me suis posée la question de savoir comment est-ce que dans une zone rurale comme Akonolinga, le corps médical a pu concilier la prise en charge de ces deux maladies ?
Au début, le personnel de santé de cette zone qui n’avait pas bénéficié de la formation a été pris au dépourvu par les premiers cas suspects.Ils n’avaient pas de matériel et cela a failli causer beaucoup d’incidents entre le personnel de santé et les populations qui voulaient des réponses. L’histoire du premier cas rapporte que les populations soutenaient qu’il était mort de Covid-19. Or, le personnel de santé n’avait pas de réponse parce que tout était centré à Yaoundé. Il a fallu attendre que le test Pcr fait à Yaoundé vienne confirmer après 48h que ce patient n’était pas mort de Covid-19. Après la décentralisation, on a pu réaliser les tests à Akonolinga. Où, le personnel de santé affirme qu’il n’a pas eu de cas de personnes internées d’Ulcère de Buruli qui ont attrapé la Covid-19. Les principaux cas venaient de l’extérieur. Ceux-ci avaient à la fois l’Ulcère de Buruli et la Covid-19. Mais refusaient carrément leur statut et préféraient gérer en automédication, les prières dans les églises et les tradipraticiens. L’hôpital les a perdus de vue.
Comment est-ce que le personnel de santé a pu gérer les deux affections pour éviter la contamination en interne de l’hôpital en attendant que les choses soient décentralisées comme vous l’avez mentionné ?
Étant entendu que tout le monde avait quand-même quelques renseignements sur les mesures barrières, ils ont construit une tente à l’esplanade de l’hôpital sous laquelle on accueillait tout le monde. Dès qu’il y avait des signes qui se rapportaient un peu au Covid, on t’envoyait d’un côté différent des autres. Ils ont bien orienté les gens à tel enseigne que ceux qui avaient l’ulcère de buruli ou la tuberculose étaient dans leur zone. Sauf qu’il y avait des problèmes avec les familles. Quand un patient est interné de tuberculose, parfois la famille ne veut comprendre qu’on l’empêche d’avoir accès à lui. Mais à force d’expliquer, le corps médical a pu maîtriser la situation. En attendant la décentralisation, il fallait se référer à Yaoundé. Donc, quand il y avait un cas suspect, ils appelaient rapidement Yaoundé. Mais ce n’était pas toujours facile parce que certaines familles étaient réfractaires. A un moment donné, selon ce que nous ont dit les personnels de santé, les taux de décès étaient élevés à Akonolinga mais il n’y avait pas moyen de dire si c’était à cause du Covid ou pas. Donc, il faut qu’on continue d’éduquer les populations. Parce qu’une autre maladie peut surgir plus tard. Concernant l’ulcère de buruli, il y a un manque de communication et d’information énorme.J’ai su que cette maladie existait il y a seulement 3 ans alors que c’est une maladie présente au Cameroun. Certains sont à Bafia, ils ont des plaies purulentes mais ne savent pas que c’est l’ulcère de buruli. Quelqu’un est à Douala, il ne sait même pas qu’il y a un hôpital de référence de prise en charge de l’ulcère de buruli à Akonolinga. Mais je pense que les personnels de santé ont fait ce qu’ils pouvaient.
Comment vivent-ils le départ de Médecins sans frontières d’Akonolinga ?
La première conséquence, c’est l’abandon. Quand Médecins sans frontières était là, le traitement était gratuit et même les repas. On allait chercher les malades jusque dans les villages. Mais aujourd’hui, qui va aller chercher qui dans un village ? Qui va prendre soin de qui ? Les lits que Médecins sans frontières a laissés depuis 2014, ne sont pas changés. Le site est dans un état délabré. Même les Ong qui arrivaient par moment pour aider ces malades, sont tous partis avec l’arrivée du Covid-19. Les patients sont tous abandonnés à eux-mêmes.
Avec ce que vous avez vu, pouvez-vous affirmer que l’ulcère de buruli n’est plus une urgence dans cette zone ?
Ceux qui font des sciences dures, parlent beaucoup plus des statistiques. Moi je fais les sciences sociales donc les statistiques ne m’intéressent pas beaucoup. C’est l’impact social, la vulnérabilité de ces personnes qui m’intéresse. Si vous arrivez dans le bâtiment qui abrite ces malades dès l’entrée, vous allez comprendre que vous êtes face à quelque chose d’horrible. Alors, est-ce qu’il faut qu’il ait 10000 cas pour qu’on se rende compte qu’il faut à tout prix les prendre en charge ? Je dis non ! Je dis que même quand l’ulcère de buruli va toucher un seul camerounais, il y aura toujours urgence. Parce que non seulement la personne est stigmatisée. Même sur le plan psychologique. J’ai vu un petit enfant qui est atteint de l’ulcère de buruli au visage et là j’ai pleuré. Alors imaginez une maman qui a fait son enfant jusqu’à l’âge de 04 à 05 ans qui a des blessures sur le visage, est-ce que vous allez attendre qu’il y ait 50 000 cas pour vous intéresser à lui ? Non ! Pour ce cas, le Cameroun doit encore se battre.
Quel a été l’impact du Covid-19 sur votre travail ?
J’avoue qu’immédiatement j’ai tout arrêté parce qu’on ne pouvait pas bouger à cause des mesures barrières. Il y avait aussi la grosse peur parce que c’était quelque chose que personne ne maîtrisait. Même pour aller au marché, c’était très dur pour moi. C’est en 2021, quand on nous a dit qu’on va apprendre à vivre avec le Covid-19 qu’on a recommencé à effectuer les descentes sur le terrain. Mais une fois sur le terrain, j’ai perdu de vue tous ceux avec qui j’étais déjà entrée en contact. Alors qu’on avait déjà eu des entretiens. J’avais 10 cas et actuellement 3 sont morts mais je ne sais pas si c’est de l’ulcère de buruli ou du Covid.
Quelles sont les recommandations que vous faites au gouvernement, aux communautés et à Médecins sans frontières ?
La première des choses, c’est la prise de conscience que cette maladie existe et qu’elle détruit les populations. Il faut que le ministre de la Santé pose un regard sur ces malades. Il faut que la communication soit assez forte sur cette maladie. Il y a aussi un problème de formation des populations parce que quel que soit ce qu’on leur dit, elles restent toujours attachées à la tradition, c’est-à-dire leur culture. L’autre chose, c’est la décentralisation. Si par exemple au niveau des mairies, les maires se penchent sur ce problème, peut-être qu’on va mieux prendre soin de ces malades.
Est-ce que ce n’est pas aussi un problème de financement qui fait entrave à la communication sur l’ulcère de buruli ?
C’est vrai. L’argent c’est le nerf de la guerre. Même ce symposium que nous avons organisé, si on n’a pas vu beaucoup de journalistes, c’est parce qu’il n’y a pas assez d’argent. Alors que si c’était un symposium sur le Sida, il devrait y avoir plein de journalistes ici parce que l’Oms finance beaucoup ça.
Réalisé par
Nadège Christelle BOWA